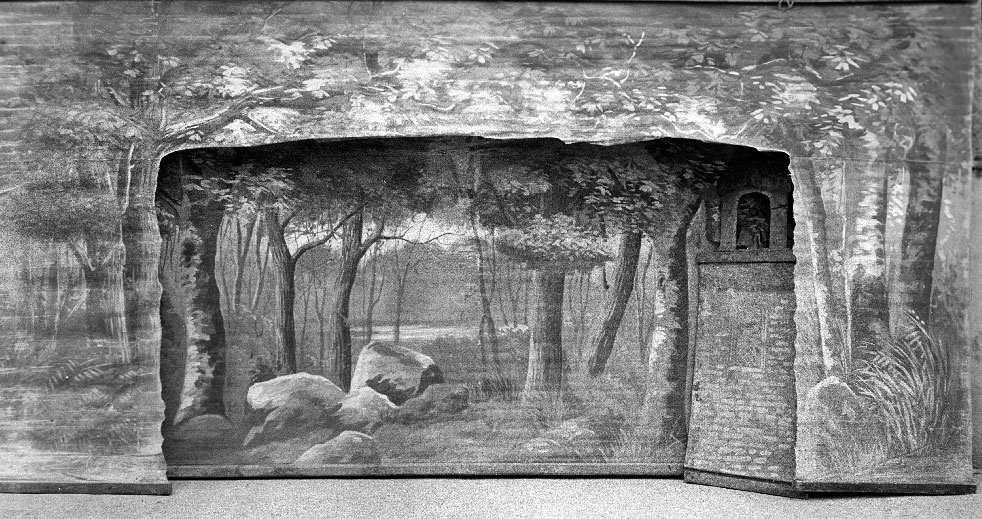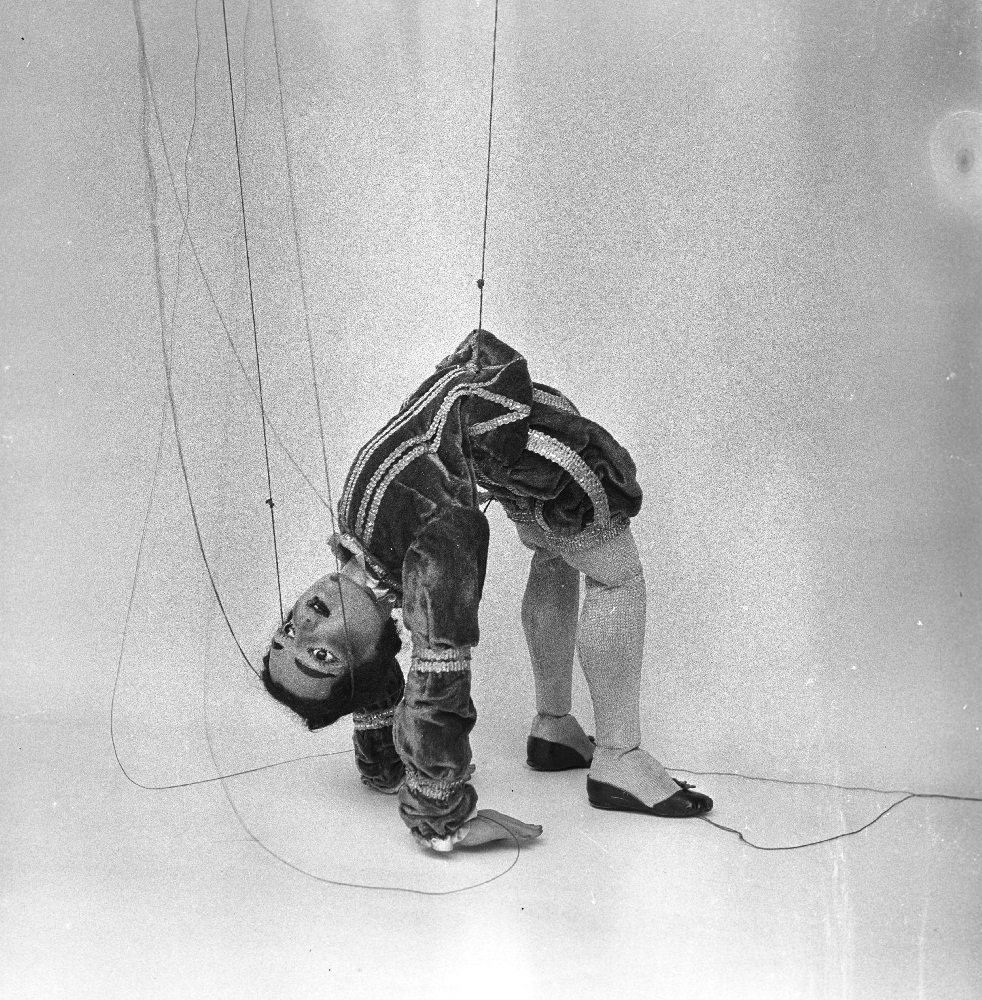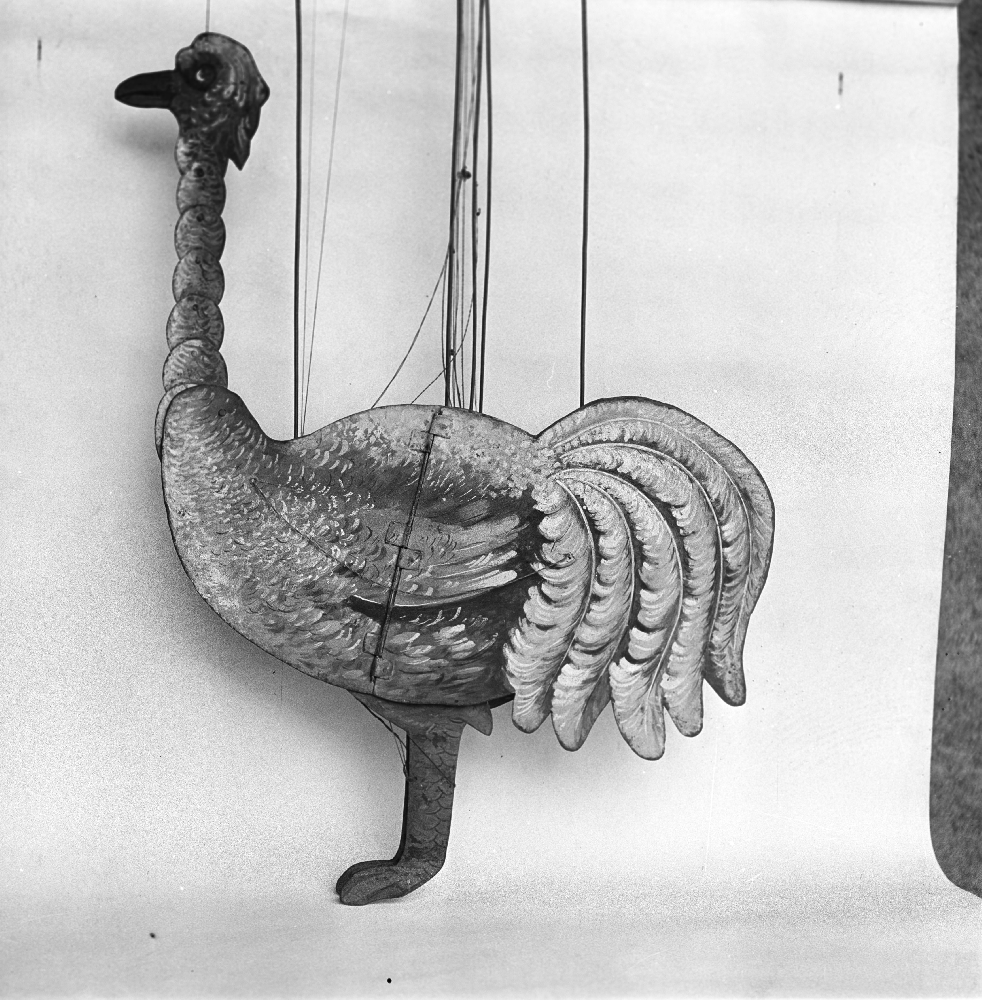A partir de 1830, et jusque dans les années 1900, la famille Collignon, directeurs et directrices d’un « spectacle mécanique », a sillonné toute la Lorraine, et probablement aussi la Haute-Marne, enchantant petits et grands avec un répertoire de marionnettes tout droit venu des illustres théâtres parisiens et italiens (revisité quelque peu…).
Installée sur la grande place des villages, leur roulotte se transformait en véritable scène grâce à un ingénieux système. C’est à dire que l’un des cotés de la voiture s’ouvrait comme un volet laissant apparaître les décors somptueux, toiles peintes de nuages pommelés, de couples d’anges volant dans l’azur, …
L’écrivain spinalien René Perrout raconte son émotion lorsqu’il retrouve, en 1912, au fond d’une grange d’Harréville-les-Chanteurs, les automates qui l’ont émerveillé enfant : Proserpine, Victor, l’enfant de la forêt, Golo, les saints, les dieux et les diables, …
C’est le « marionnettiste » lui même, M. Collignon, qui lui fait alors la visite et, si les automates lui paraissent défraichis et comme « endormis pour l’éternité » dans leurs caisses de bois poussiéreuses, la magie opère tout de même et l’écrivain jubile en découvrant les subterfuges qui l’ont tant fait rêver.
Il est tout attendri par les systèmes astucieux inventés par les “mécaniciens”, en particulier celui qui fermait et ouvrait les paupières des poupées de bois.

J’ai donc remonté la généalogie de la famille COLLIGNON, marionnettistes habitant à Harréville-les-Chanteurs (Haute-Marne).
Le premier à être qualifié de « directeur de théâtre mécanique ambulant » est Melchior Collignon, né en 1809 à Petit-Failly, en Meurthe-et-Moselle. Il épouse Marie Servaux, marchande-colporteuse domiciliée à Harréville-les-chanteurs.
Trois de leurs enfants se marient avec les petits enfants de Charles Rémy BORGNIET, artiste né à Reims en 1778.
Rémy Borgniet et ses descendants (LEVERGEOIS, DULAAR, ROUSSEL) animèrent simultanément et/ou successivement les célèbres théâtres du Petit Poucet et des Lilliputiens.
Les familles de forains avaient pour habitude de se marier entre eux pour préserver l’exploitation de leur « métier», c’est-à-dire un complexe de biens d’équipement (roulotte-théâtre , décors, marionnettes, accessoires, répertoire).
Les COLLIGNON sont donc une branche de ce fameux artiste BORGNIET !
La famille Borgniet se scinde en deux branches autour de 1860, d’un côté les Collignon, qui sillonnent la Lorraine et de l’autre, les Levergeois, actifs en Normandie.
Contrairement au Levergeois-Dulaar-Roussel, fondateurs et exploitants de plusieurs théâtres ambulants jusque dans les années 1940, la branche des marionnettistes « Collignon » s’éteint vers 1900/1910.
En 1912, à Haréville-les-Chanteurs, en Haute-Marne, c’est donc le dernier « mécanicien ambulant » de Lorraine et de Haute-Marne que visite avec émotion l’écrivain spinalien René Perrout.
Voici son texte magnifique (Promenades sentimentales, 1912)
Article et recherches Pascale Fourtier-Debert, 2024.
Spéciale dédicace à Pascal DUFOUR et Jean-Pierre IDATTE.
Illustrations © PAM LE LAB, portail des arts de la marionnette
Histoire des marionnettes en Europe, Magnin_Charles
Des marionnettes foraines aux spectacles de variétés : les théâtres Borgniet / Marie-Claude Groshens ; Musée des arts et traditions populaires
Tombe de la famille Collignon, Harréville-lès-Chanteurs


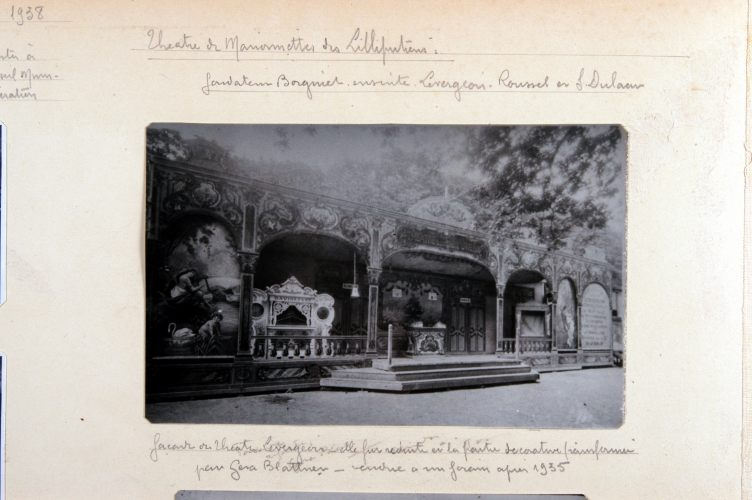
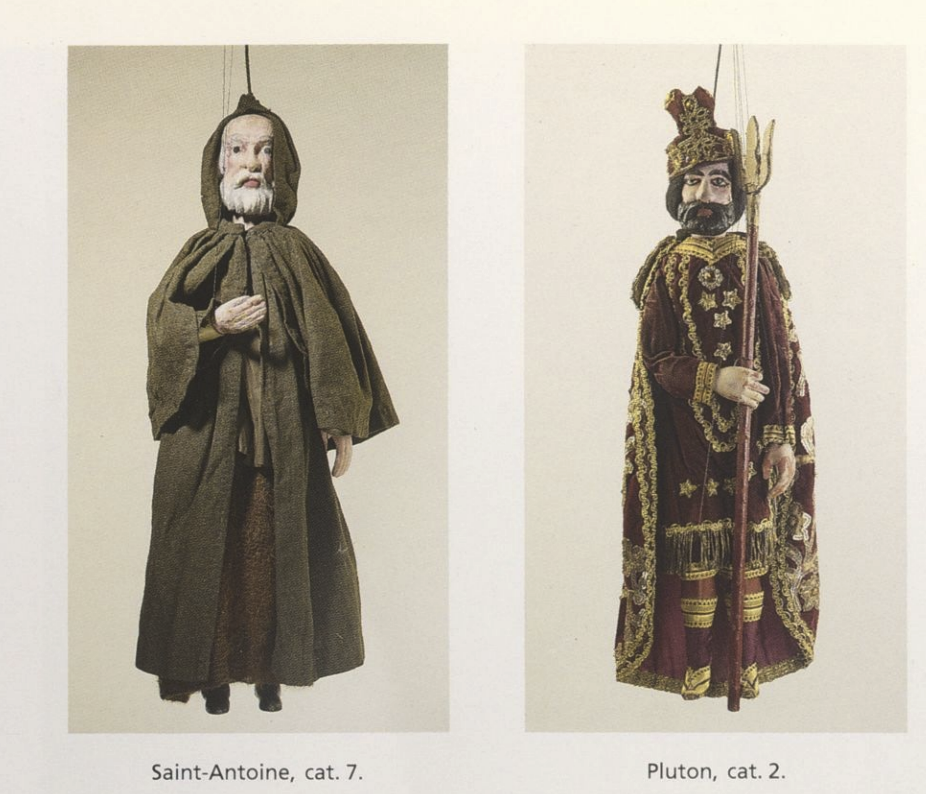
“Les Marionnettes de M. Collignon“,
René Perrout, Promenades sentimentales, 1912
Texte entier ici
Il est, aux confins du département des
Vosges, non loin de la Haute-Marne, un
petit village d’une grande douceur.
[…]
Si l’on gravit la côte derrière les maisons,
si l’on franchit le plateau aux terres arides,
coupées de haies, de buissons et de pier-
riers, pareil à une solitude qui s’offre,
lourde de paix, aux baisers du soleil, on
gagne, au sortir d’un bois, le village
d’Harréville-les-Chanteurs.

[…]
Ce village a un nom sonore. Sans doute
lui vient-il de ce que ses habitants parcou-
raient autrefois les pays voisins, montrant
l’image de saint Hubert, des reliques
enfermées dans une armoire qu’ils por-
taient sur leur dos à la façon d’une
hotte, vendant des chapelets, des médailles
et chantant des cantiques ou des com-
plaintes. On les appelait, comme les Cha-
magnons, les montreurs de Saint-Hubert.
On n’en rencontre plus. La race en est
éteinte, comme s’éteint la poésie dans
l’âme populaire. […]

Atelier lorrain, photographie P. Fourtier-Debert, 2017
[…]
Un jour du dernier automne, je fus à
Harréville. Vous daignâtes, mon cher
poète, m’y accompagner. Nous allions
visiter M. Collignon, le célèbre imprésario
des Grands Automates que les enfants de
Lorraine ont tant aimés. Il achève de vivre
là, au milieu de ses marionnettes.
[…]

[…]
Nous l’abordâmes poliment et je
lui demandai s’il connaissait M. Collignon.
Il me répondit avec infiniment de grâce :
— C’est moi-même, Monsieur. En quoi
puis-je vous servir ?
Son aspect était aimable. Sa bouche, ses
yeux, les rides de son front et de ses joues,
toute sa figure souriait. Elle reflétait la
sérénité du terrien qui vit sur le vieux sol,
la politesse, l’emphase du vieil acteur, la
finesse de l’artiste. M. Collignon, le père
Collignon, pour moi, était tout cela.
[…]
Je lui demandai s’il avait encore son
théâtre, ses décors, ses marionnettes et
s’il lui plairait de nous les montrer. Je
m’excusai de mon indiscrétion.
[…] Je lui dis que j’avais été jadis
à Epinal avide de ses spectacles. […]
Je me sentis gonflé de joie quand il nous
invita, le bonnet à la main, à pénétrer
dans sa demeure. Les grands automates y
étaient enfermés, dans la poussière et
dans la paix d’une grange et nous allions
les voir.
Mon cœur bondissait. C’était une partie
de mon enfance qui allait se lever devant
moi, dans un hallier obscur d’un village
lointain, embrumé de pluie et de tristesse.
[…]
[…]
M. Collignon nous conduisit dans un
étroit réduit, sombre, poudreux, encombré
d’un établi, de ferrailles et d’outils. Une
armoire boiteuse renfermait les décors et
les accessoires, les canons de Victor l’enfant
de la forêt, la cloche, l’apothéose de Saint-
Antoine. Les automates gisaient, démontés,
dans deux longues caisses, sans ornements
et sans guirlandes, pareilles à deux coffres
à bois.
Etait-ce possible ? Ces décors, ces toiles,
ces machines qui me semblaient jadis
l’ouvrage de la magie, les tranches d’azur,
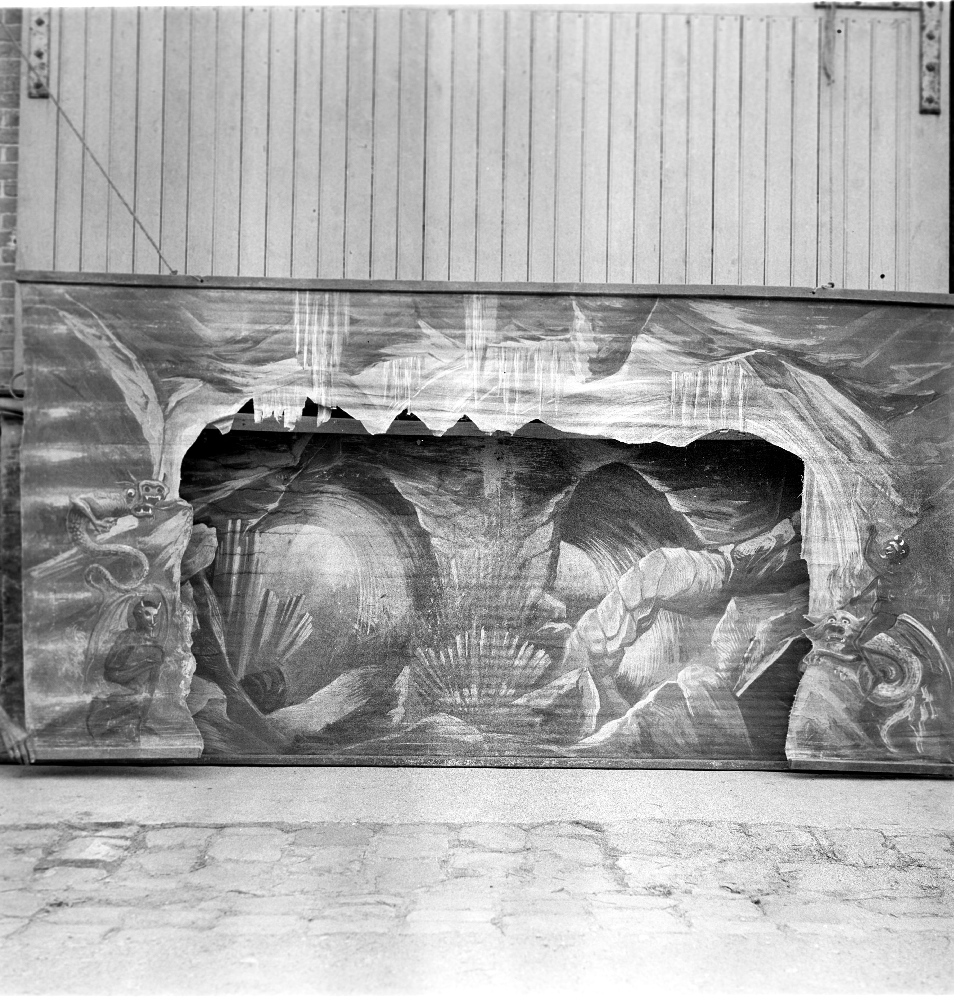
[…]
les nuages pommelés, les couples d’anges,
les gloires parmi lesquelles Antoine gagnait
l’éternité, je les retrouvais pliés, roulés,
empaquetés dans un pauvre meuble. Ces
personnages augustes, des seigneurs, des
princes, des saints, Dieu même, je les
voyais privés de leurs vêtements, désar-
ticulés, dévissés, déshonorés et jetés
pêle-mêle dans une boite. Etait-ce possible?
Je sentais un effondrement, le chagrin
d’un rêve envolé, d’une joie perdue, d’une
clarté éteinte. Et, soutenant dans ma main
la tête de Golo, comme Hamlet portait un
crâne, j’allais me prendre à méditer
comme ce triste prince sur la fuite du
temps et le néant de tout.
Cependant M. Collignon exhumait les
automates avec beaucoup de complaisance.
L’un après l’autre, pièce par pièce, membre
par membre, il les tirait de leur tombeau.
[…]
[…]
Nous vîmes défiler, comme des évoca-
tions, le chef de saint Antoine, le crâne
bossué, légèrement pointu, le regard
inquiet, de l’inquiétude des pauvres, les
diables de la Tentation, jaunes, verts,
rouges, multicolores, un squelette dont les
os se choquaient, un petit démon ingénieux
et noir, dont les jambes étaient des pattes
de chevreuil et les griffes des ongles de
poulet ; Pluton, roi des Enfers, dont les
prunelles blanches tranchaient sur ses
joues noires, ses sourcils et sa barbe
rouges ; Crésus, son premier ministre, la
ace barbouillée de vert et de carmin ;
[…] le compagnon du saint, le brave petit cochon
fraternel qui partageait avec son maître
les tourments des démons. Ils l’entraî-
naient de force malgré ses grognements
de détresse. Et quand il revenait sur
la scène, une gerbe d’étincelles jaillissait
de son derrière. Je distinguai la place
noircie de la fusée et j’eus l’explication
triviale d’un effet de scène qui me semblait
merveilleux.
[…]
[…] Qui me l’eût dit
alors ? Les paupières étaient mues par une
ficelle. Et voici que je la tirais moi-même
et que je faisais cligner les paupières de
Golo. Ce désenchantement, n’est-ce pas
l’image de toute la vie ?
[…] Ainsi les Collignon, de père en fils, d’aïeul
en petit-fils, parcoururent la Lorraine pendant
plus d’un siècle, s’arrêtant dans les villages,
[…]
Le texte complet ici

Notes Remarques sur l’utilisation : Le numéro comprend trois éléments : le matelot et ses accessoires (bouteille et vêtements), et deux marionnettes à tringles classiques. Quatres fils sont attachés aus vêtementsdu matelot et permettent de le déshabiller. Le numéro comprend quatre phases : le matelot arrive en titubant ; il enlève sa veste et fait chuter sa bouteille; tombant sur son derrière, il continue de se déshabiller ; Polichinelle et un agent de police interviennent pour le pousser dehors. La marionnette, acquise par la famille Dulaar-Roussel, a été utilisée dans leur théâtre forain itinérant, le Théâtre de Lilliputiens. PAM LE LAB, portail des arts de la marionnette
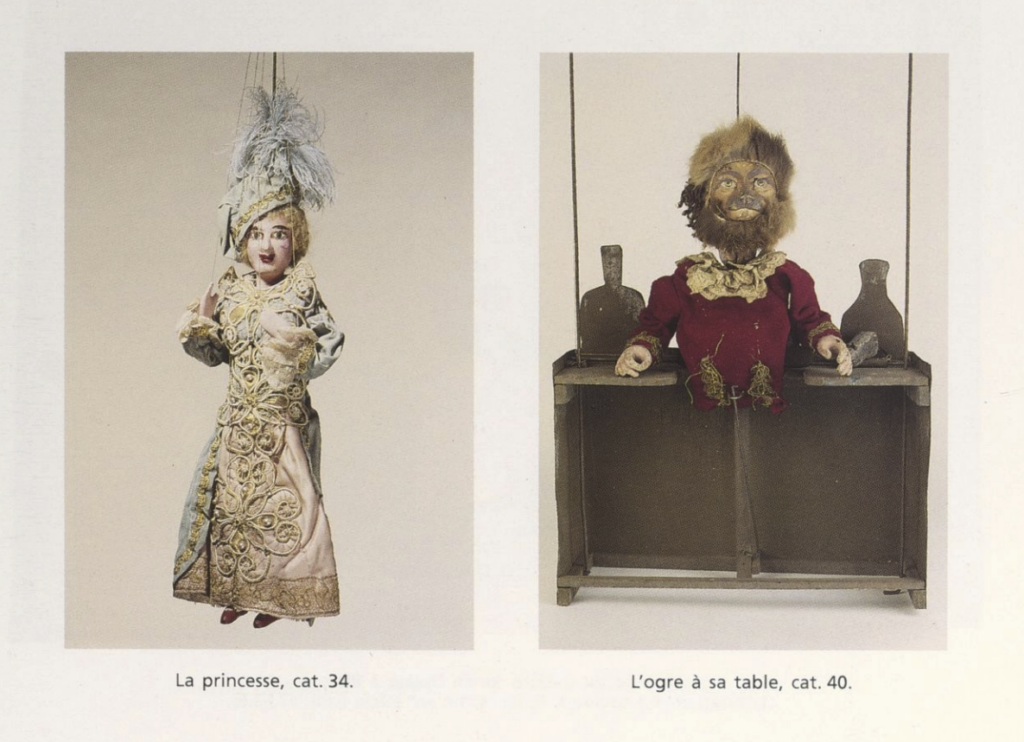
© Portail des arts de la marionnette